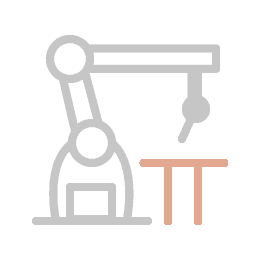Introduction
Cure de jonction pyélo-urétérale : définition et indications
Les reins ont pour fonction principale de filtrer le sang pour en éliminer les impuretés via l’urine qu’ils produisent. Celle-ci est alors transférée par les uretères de chaque rein à la vessie, organe de stockage de l’urine entre deux mictions. Le passage entre le rein, plus précisément l’une de ses cavités appelée « bassinet », et l’uretère est dénommé jonction pyélo-urétérale.
Chez certains patients la jonction pyélo-urétérale présente un rétrécissement. Généralement unilatérale (95% des cas), c’est la malformation congénitale du rein la plus courante : elle touche environ 1 nouveau-né sur 500. Bien que cette pathologie puisse parfois être détectée avant la naissance, elle est plus souvent découverte tardivement, après être restée dormante pendant de longues années. Pratiquement, elle s’explique par une compression de la jonction pyélo-urétérale par l’une des artères du rein ou un défaut de la paroi musculaire du bassinet qui induit une diminution de diamètre. Hormis son origine congénitale, plus rarement, le rétrécissement de la jonction pyélo-urétérale peut être consécutif à une maladie ayant entraîné une inflammation.
Quelle qu’en soit la cause, le syndrome de la jonction pyélo-urétérale fait que l’urine s’écoule difficilement vers l’uretère. Cette rétention induit une dilatation des cavités rénales. Elle est fréquemment source de douleurs et d'infections récidivantes, pouvant par ailleurs entraîner une destruction progressive du rein.
Le traitement mis en place dépend de la sévérité du rétrécissement. Parfois, des mesures médicales peuvent s’avérer suffisantes. Mais, dans d’autres cas, une chirurgie est nécessaire. Elle peut alors prendre des formes diverses : dilatation sous endoscopie, ou, notamment dans les cas de récidive, réparation de la jonction pyélo-urétérale en supprimant la partie rétrécie. C’est la « pyéloplastie » ou cure de jonction pyélo-urétérale.
Dans ce cas, la réalisation d’une intervention chirurgicale par utilisation du robot chirurgical Da Vinci® permet de minimiser le caractère invasif de la chirurgie, d’en accroître la précision, d’en alléger les suites opératoires et d’en diminuer les risques de complications.
Cure de jonction pyélo-urétérale : déroulement
La cure de jonction pyélo-urétérale en pratique
La durée de l’intervention varie de 1 à 2 heures et elle se déroule sous anesthésie générale. Une consultation avec l’anesthésiste est donc nécessaire au moins 48 heures avant l’opération.
Le patient doit par ailleurs préciser ses antécédents médicaux et signaler les traitements qu’il suit, en particulier ceux à effet anticoagulant. Enfin, une analyse d’urine doit être réalisée avant l’intervention, pour s’assurer de l’absence d’une infection ou sinon prendre celle-ci en charge, ce qui peut alors nécessiter de reporter la chirurgie.
Déroulement
L’intervention a lieu sous cœlioscopie robot-assistée , c’est-à-dire que l’accès aux structures à opérer se fait de façon mini-invasive, via des minuscules incisions pratiquées dans la paroi abdominale.
Le patient est allongé et les bras du robot Da Vinci®, équipés d’instruments chirurgicaux miniaturisés et d’une mini-caméra, sont positionnés au-dessus de lui. Ils sont manipulés par le chirurgien à partir d’une console de commande équipée d’écrans qui retransmettent des images en 3D de l’intérieur de l’abdomen.
Le principe de cet acte chirurgical est de retirer la zone lésée de l’uretère puis de pratiquer une suture pour relier sa partie saine au bassinet. Par ailleurs, une sonde est mise en place, pour ne pas mettre sous pression la jonction réparée et éviter que le patient ne rencontre des difficultés urinaires au réveil.
Après l’intervention
Suites opératoires
Selon les cas, l’intervention se déroule en mode ambulatoire ou bien une courte hospitalisation (24 à 48 heures) peut être nécessaire. Ce mode opératoire robot-assisté fait que les douleurs post-opératoires sont généralement très modérées. Elles ne perdurent que quelques jours et le traitement antalgique prescrit suffit à assurer le confort du patient. Il est possible de se lever le soir même et de s’alimenter normalement. La sonde urinaire est en général retirée dès le lendemain de la chirurgie.
La convalescence dure quelques semaines et le retour progressif aux activités physiques et professionnelles est rythmé par le praticien. Par rapport à une chirurgie classique, le caractère mini-invasif de l’intervention pratiquée réduit la durée de la période de récupération de manière significative.
Le suivi post-opératoire est bien entendu essentiel. Grâce aux examens radiologiques réalisés, il permet de s’assurer de l'absence de récidive du rétrécissement, de surveiller le bon fonctionnement des reins et de détecter d’éventuelles complications.
Complications éventuelles
Bien que possibles en théorie, comme pour tout acte chirurgical, les complications de la pyéloplastie robot-assistée sont rares. En particulier, la précision des gestes qu’assure le robot Da Vinci® minimise considérablement les risques d’hémorragie ou de lésion des organes proches du site opératoire. De plus, la taille extrêmement réduite des incisions fait que le risque infectieux est très faible.
Résultat
L’intervention est un succès chez la plupart des patients opérés : la pyéloplastie permet de restaurer définitivement un diamètre satisfaisant qui permet à l’urine de cheminer normalement du rein vers la vessie.
Cependant, des cas de récidive sont parfois rapportés. Une nouvelle intervention peut alors s’avérer nécessaire, et, dans les cas les plus extrêmes, l’ablation du rein doit parfois être envisagée.