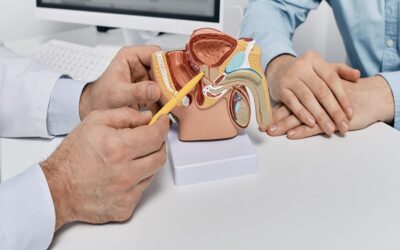L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP), affection masculine fréquente après 50 ans, correspond à une augmentation non cancéreuse du volume de cette glande. Elle touche la zone entourant l’urètre et, par compression, provoque des troubles de la miction. Le traitement dépend de la sévérité des symptômes et du volume prostatique. Il peut s’agir d’une simple surveillance, de la prise de médicaments, ou d’une intervention chirurgicale qui prend des formes plus ou moins invasives.
Hypertrophie de la prostate : rappel
L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP), également appelée adénome de la prostate, désigne une augmentation non cancéreuse du volume de la glande prostatique. Elle survient fréquemment après 50 ans, en raison de modifications hormonales impliquant notamment la testostérone et ses dérivés.
L’HBP touche la partie de la prostate située autour de l’urètre et impacte donc la miction. Les symptômes de cette affection incluent un jet urinaire faible, des besoins fréquents d’uriner (surtout la nuit), une sensation de vidange incomplète et des envies urgentes. L’évolution de l’HBP est généralement lente, mais, à terme, elle peut significativement impacter la qualité de vie.
Hypertrophie de la prostate, quel traitement choisir ?
Le mode de traitement de l’HBP dépend de l’intensité des symptômes, du volume prostatique, de l’âge du patient et de ses préférences, allant d’une simple surveillance à des techniques chirurgicales mini-invasives ou classiques.
Le traitement médical constitue souvent la première étape, notamment en cas de symptômes modérés. Les alpha bloquants, tels que la tamsulosine, agissent rapidement en relâchant les fibres musculaires lisses autour de l’urètre, facilitant ainsi la miction. Les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase (comme le finastéride ou le dutastéride) ont un effet plus lent, mais permettent de réduire progressivement le volume de la prostate. Cependant, ces médicaments nécessitent une prise prolongée et peuvent entraîner des effets secondaires, notamment d’ordre sexuel. En cas d’échec ou d’intolérance aux médicaments, plusieurs options chirurgicales ou mini-invasives sont alors envisageables.
La résection transurétrale de la prostate (RTUP) est l’intervention historique de référence pour les prostates de taille modérée. Réalisée par voie endoscopique, elle consiste à retirer le tissu obstructif via l’urètre. Elle est efficace mais peut provoquer une éjaculation rétrograde, phénomène bénin qui correspond à un reflux du sperme dans la vessie lors de l’orgasme, avant d’être éliminé naturellement dans les urines.
Cette intervention est aujourd’hui supplantée par l’énucléation endoscopique au laser Holmium (HOLEP) ou Thullium (THULEP) présentées plus loin.
Pour les petites prostates (moins de 30 mL), une alternative plus légère est l’incision cervico prostatique (ICP). Le principe est alors d’inciser le col vésical (partie inférieure de la vessie) et la partie interne de la prostate, pour élargir le canal urinaire, sans retirer de tissu.
Le traitement au laser, quant à lui, s’adapte à toutes les tailles prostatiques. L’énucléation endoscopique au laser Holmium (HOLEP) ou Thullium (THULEP) a l’avantage de diminuer le saignement, le temps opératoires, la récidive et il n’y a pas de cicatrice.. Elle n’est réalisée que par des opérateurs expérimentés.
Quand le volume de la prostate est supérieur à 80 mL, une adénomectomie robotisée peut aussi être envisagée. Réalisée par voie coelioscopique et assistée robotiquement, elle permet une ablation précise de l’adénome.
Par ailleurs, chez les patients jeunes présentant un adénome de faible volume, la pose d’implants Urolift® représente une alternative innovante. Cette technique consiste à écarter mécaniquement les lobes prostatiques pour libérer le canal urinaire, sans retirer de tissu ni altérer l’éjaculation.
Enfin, chez les sujets ne pouvant bénéficier d’une chirurgie classique, l’embolisation des artères prostatiques constitue une solution mini-invasive. Pratiquée par voie endovasculaire, elle vise à réduire l’irrigation sanguine de la prostate, pour en diminuer progressivement le volume.
Quel que soit le traitement choisi, un suivi médical régulier est indispensable afin de surveiller l’évolution des symptômes, évaluer l’efficacité de la prise en charge et prévenir d’éventuelles complications.